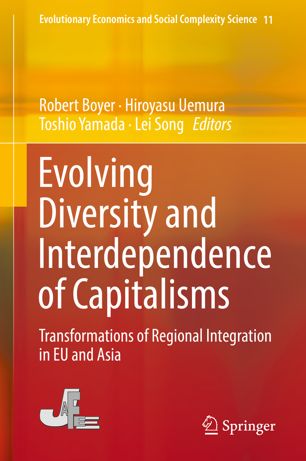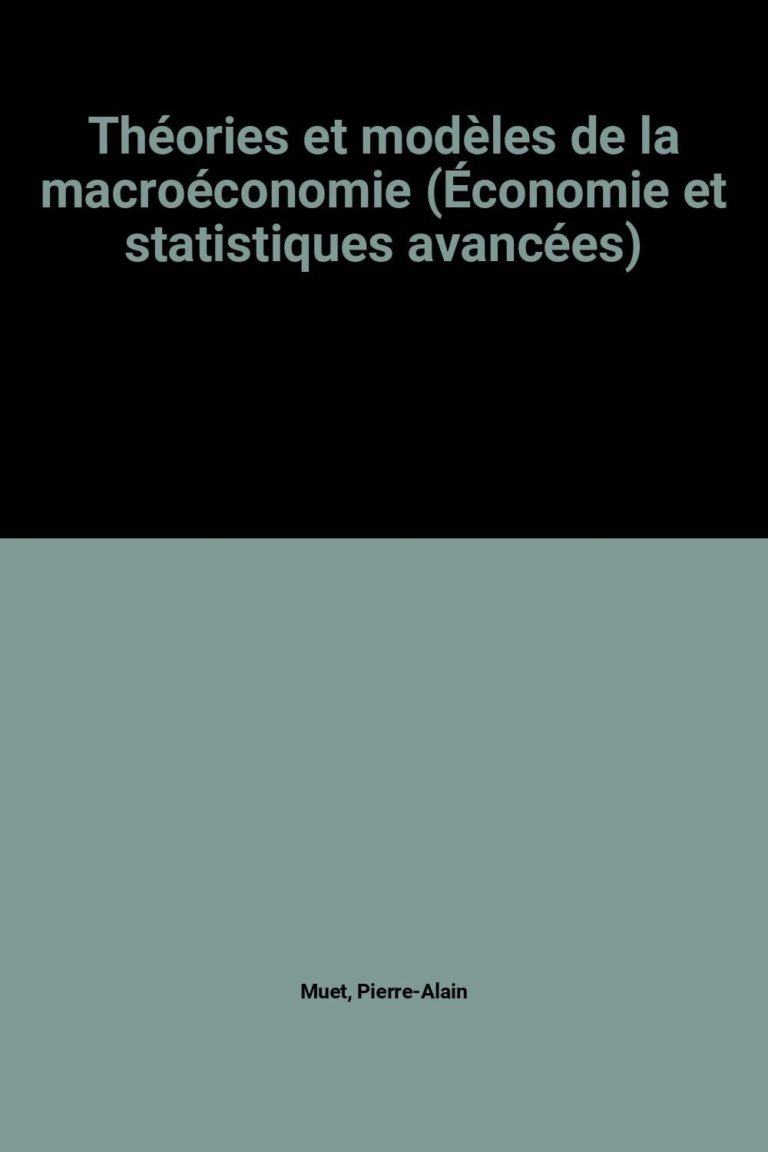in Boyer Robert, Toshio Yamada, and Lei Song (Eds), Evolving Diversity and Interdependence of Capitalisms. Transformations of Regional Integration in EU and Asia, book series (EESCS, volume 11), Springer, Japan KK, part of Springer Nature 2018, p. 17-64
Dans Expectations, Narratives, and Socio-Economic Regimes, Jens Beckert & Richard Bronk, 2018, Oxford univesity press, Oxford, Chapter 2, pages 39-61.
Libération, 15 septembre 2018, p. 8-9.
Suivre l’évolution d’un paradigme au gré des transformations des capitalismes contemporains, R. Boyer (dir), Avril 2018, Editions des maisons des sciences de l’homme associées, Collection interdisciplinaire EMSHA , La Plaine Saint Denis
Le présent ouvrage propose au lecteur un aperçu sur la trajectoire intellectuelle d’un groupe de chercheurs qui se sont attachés à éclairer certaines questions liées à la recherche sur l’économie et la société selon les approches développées par la Théorie de la Régulation, ceci à travers un permanent aller-retour entre les enseignements et prédictions du cadre conceptuel élaboré pour rendre compte de la rupture des Trente glorieuses et de la réalité des évolutions observées depuis lors.
La particularité du présent ouvrage est de donner à voir l’ajustement de ce paradigme d’année en année jusqu’à la période contemporaine. En quelque sorte, il propose de visiter le laboratoire d’où sont sorties les nombreuses publications dérivées de la Théorie de la Régulation.
Présentation powerpoint au Séminaire « Planning and Long-Term Perspective in Economics », INALCO, Paris, 6 Avril, 2018
Présentation au Colloque « Gouvernement, Participation et Mission de l’entreprise », Collège des Bernardins, Paris,
16 mars 2018
Entrevue du 1er Mars 2017, Institut des Amériques, Paris.